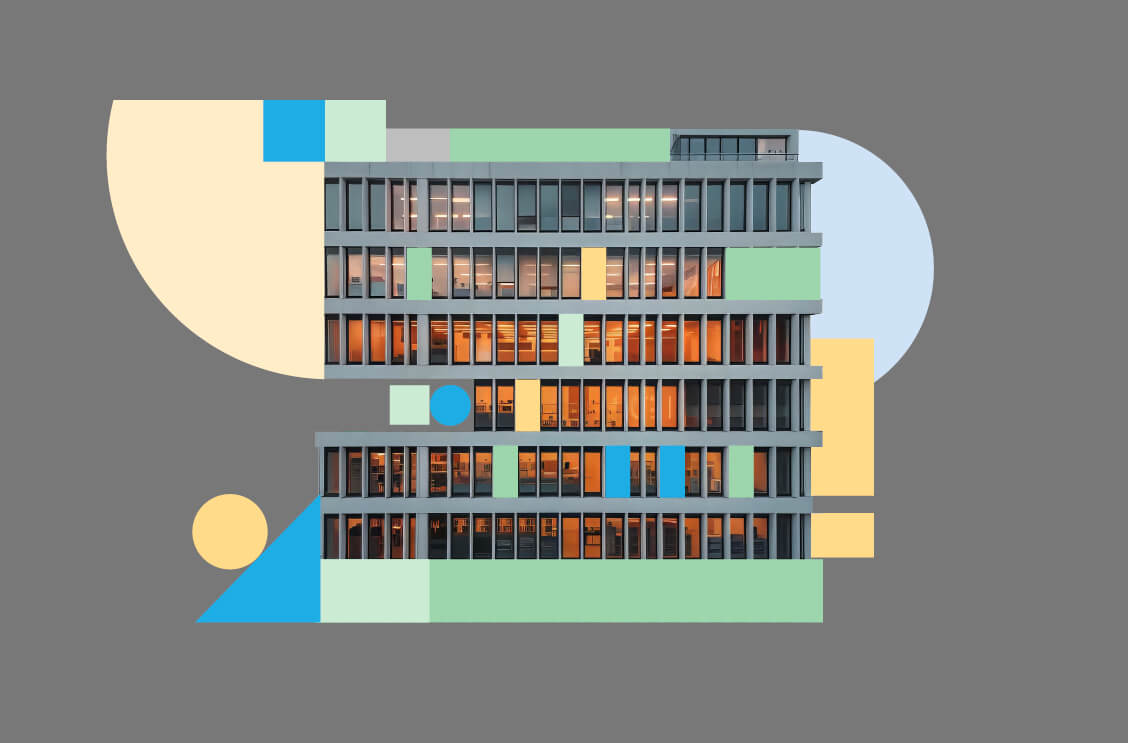
Au 2ᵉ trimestre 2025, l’offre de surfaces de bureaux en Suisse restait environ 0,7 % en dessous du niveau de l’année précédente. Le point bas du nombre d’annonces semble toutefois dépassé : depuis le début de 2025, le nombre de surfaces proposées sur le marché augmente à nouveau légèrement (figure 1). Ce constat surprend, car au cours des deux dernières années – à l’exception de quelques grands projets – très peu de nouvelles surfaces ont été créées. Les volumes d’investissement autorisés pour de nouvelles surfaces de bureaux étaient nettement inférieurs à la moyenne décennale en 2023 (−45,8 %) et en 2024 (−17,2 %). Dernièrement, l’activité de construction a toutefois légèrement repris, ce qui laisse entrevoir, à moyen terme, une augmentation supplémentaire de l’offre de constructions neuves (voir à ce sujet l’article de l’Immo-Monitoring publié simultanément : « Le marché de la construction est revenu sur la voie de la croissance »).
La récente augmentation des surfaces annoncées s’explique principalement par un affaiblissement de la demande. Les années précédentes, une forte croissance de l’emploi avait soutenu la demande de surfaces de bureaux et compensé les effets du télétravail et du partage de bureaux (« desk sharing »). Au 2ᵉ trimestre 2025, le nombre d’équivalents plein temps (EPT) dans les branches de bureau n’a progressé que de 0,9 % par rapport à l’année précédente – bien en dessous de la moyenne décennale de +1,7 % (figure 2). Une croissance aussi faible de l’emploi n’avait plus été observée depuis 2017. Pour les prochains trimestres, seule une augmentation modérée est attendue – d’une part en raison des incertitudes conjoncturelles, d’autre part en raison de l’utilisation accrue de l’intelligence artificielle (IA), qui permet des gains d’efficacité notamment dans les activités administratives.
Au sein des branches de bureaux classiques, les tendances d’évolution diffèrent au 2ᵉ trimestre 2025 : l’administration publique enregistre une nette progression de l’emploi de +3,3 % sur un an – bien au-dessus de la moyenne décennale de +1,3 % – et constitue ainsi un moteur essentiel de la croissance actuelle de l’emploi dans le secteur de bureaux.
À l’inverse, les autres branches de bureaux ont nettement perdu en dynamisme ; dans certains domaines, l’emploi a même reculé. La baisse est particulièrement marquée dans le secteur informatique : après avoir enregistré pendant une décennie des taux de croissance moyens supérieurs à 4,0 % par an, la croissance n’atteint plus que 0,4 % en glissement annuel. Un facteur possible de ce ralentissement réside dans les gains de productivité générés par l’IA générative.
La baisse la plus marquée a été enregistrée dans la branche « services financiers », avec −2,0 % par rapport à l’année précédente. Dans ce domaine, la numérisation croissante, l’automatisation liée à l’intelligence artificielle ainsi que la consolidation dans le secteur des grandes banques freinent l’évolution de l’emploi.
La baisse de la demande de surfaces de bureaux a des influences diverses selon les régions (figure 3). La hausse cumulée de l'offre d’environ 3 % dans les cinq grands centres suisses masque ces divergences. Bâle enregistre la plus forte baisse de l’offre (−11,4 %) : au cours des deux dernières années, très peu de nouvelles surfaces de bureaux ont été autorisées, de sorte que peu de nouveaux bâtiments arrivent actuellement sur le marché. Une diminution marquée a également été observée à Lausanne (−6,0 %). À Berne (+2,4 %) et à Zurich (+2,9 %), les surfaces annoncées ont en revanche légèrement augmenté. La hausse est la plus marquée à Genève : le nombre d’annonces y a progressé de plus de 15 % sur un an ; au 2ᵉ trimestre 2025, plus de 8,5 % du parc étaient proposés sur le marché. À Genève, le moteur de cette progression réside dans l’achèvement de nouvelles surfaces de bureaux au premier semestre 2025.
Les taux de l’offre dans les agglomérations restent nettement supérieurs à ceux des villes-centres. L’écart est particulièrement marqué dans la région lémanique : dans les communes d’agglomération, plus de 15 % du parc étaient en moyenne proposés à la location. La différence est la plus faible dans la région de Bâle : en ville, 4,3 % du parc étaient disponibles, contre 6,1 % dans l’agglomération, soit à peine davantage.
Le sous-segment des espaces de coworking a pris une importance considérable sur le marché des surfaces de bureaux au cours des dernières années. Depuis 2016, le nombre d’emplacements a augmenté en moyenne de 27 % par an. Alors que ces surfaces ne représentaient à l’époque qu’un phénomène de niche à l’échelle du millième de l’ensemble des annonces de bureaux, elles constituent environ 7 % de l’offre totale au 2ᵉ trimestre 2025. Les signes d’une saturation du marché se multiplient toutefois : entre 2024 et 2025, le nombre d’espaces n’a augmenté que de 3,8 %, ce qui représente un net ralentissement de la croissance. Parallèlement, le nombre d’annonces de coworking destinées aux utilisateurs finaux a augmenté de près de 27 %. Cela suggère que les exploitants ralentissent leur expansion pour concentrer davantage leurs efforts sur le taux d’occupation, la commercialisation et l’optimisation des surfaces existantes.
Dans les grands centres, l’ouverture de nouveaux espaces de coworking s’est pratiquement arrêtée ; la dynamique s’est également nettement ralentie dans les agglomérations ainsi que dans les petits et moyens centres. Partant d’un niveau bas, l’offre continue toutefois de croître en périphérie, quoique de manière plus modérée (figure 5). De nouveaux sites ont encore été ouverts, notamment dans des régions à vocation touristique comme Laax ou Nendaz, portés par des concepts de workation et des formes de travail hybrides. Dans ces régions, les fournisseurs de coworking profitent du fait que des loyers de marché relativement bas rencontrent une disposition à payer typiquement urbaine.
Après trois années de tendance à la baisse, l’offre de surfaces de bureaux a de nouveau augmenté en 2025, mais avec des évolutions régionales nettement contrastées. Tandis que Bâle et Lausanne enregistrent des reculs, l’offre a progressé à Zurich, à Berne et surtout à Genève. Dans les agglomérations, le taux de l’offre reste, dans de nombreux cas, supérieur à celui des villes-centres.
Une légère reprise de l’activité de construction et un ralentissement de la croissance de l’emploi plaident actuellement en faveur d’un nouvel élargissement de l’offre de surfaces annoncées. Dans le segment du coworking, la dynamique s’est sensiblement ralentie à l’échelle nationale, en particulier dans les grandes villes. En périphérie et dans les régions touristiques, le nombre de sites continue en revanche d’augmenter, bien que sur un niveau relativement bas.
Pour une évaluation complète de l’offre, ce ne sont pas seulement la situation géographique ou le segment de marché qui sont déterminants, mais aussi la nature et la qualité des surfaces annoncées – un aspect auquel nous consacrons la section suivante.
L’offre de surfaces de bureaux se caractérise par une grande hétérogénéité en matière de standard d'aménagement. Ce dernier détermine dans une large mesure la rapidité et les conditions de location des surfaces, ainsi que le montant de l’investissement pour les propriétaires. Il décrit le niveau d’achèvement d’une surface lors de sa remise au locataire, allant de la structure de base jusqu’au bureau entièrement équipé.
Afin d’unifier la multitude de termes et d’interprétations, les Swiss Valuation Standards (SVS) organisent systématiquement les niveaux de finition en quatre catégories :
L’analyse des surfaces actuellement annoncées montre que la frontière entre l’aménagement de base et l'aménagement semi-fini est souvent floue et que de nombreuses annonces ne peuvent pas être classées de manière nette. Parallèlement, une partie des surfaces est déjà proposée meublée et entièrement équipée. Nos analyses ont également examiné s’il s’agit de surfaces de coworking, car celles-ci offrent, en plus du mobilier, des services et prestations supplémentaires par rapport aux surfaces classiques de type « Plug & Work ».
Sur cette base, les annonces ont été réparties en cinq catégories :
Pour l’analyse, les annonces publiées depuis le début de l’année 2024 ont été classées, sur la base de leurs descriptions, aussi précisément que possible en cinq catégories. Pour ce faire, à la fois des méthodes heuristiques classiques utilisant des filtres de reconnaissance de texte et différents grands modèles de langage (Large Language Models) ont été employés (voir encadré méthodologique).
Environ 55 % de l’ensemble des annonces concernent des surfaces de bureaux entièrement aménagées. Viennent ensuite les surfaces meublées avec 20 %, et celles en aménagement de base ou semi-fini avec 15 % (figure 6).
Lorsqu’on pondère l’analyse par la surface, la part des surfaces en aménagement complet reste certes dominante, mais elle recule au profit des niveaux de finition inférieurs. Les parts des surfaces meublées et coworking diminuent également (figure 7).
Cela correspond aux attentes : les petites surfaces sont plus souvent aménagées, car les petits locataires n’ont généralement ni l’intérêt ni les ressources pour réaliser leur propre aménagement. En revanche, les grands locataires disposant d’une forte capacité financière se voient souvent proposer un niveau de finition inférieur, afin qu’ils puissent effectuer eux-mêmes les travaux et adapter les locaux à l’identité de leur entreprise.
Les écarts de niveau de finition sont particulièrement marqués entre les nouvelles constructions et les bâtiments existants (figures 9 et 10). Dans les nouvelles constructions dominent les surfaces présentant des niveaux de finition plus bas, tels que le gros œuvre et l’aménagement de base ou semi-fini. Les propriétaires renoncent souvent volontairement à une finition complète afin d’offrir aux locataires une plus grande flexibilité dans l’aménagement individuel et, en même temps, de réduire leurs propres risques de coûts. L'aménagement semi-fini offre une base moderne avec des préinstallations pouvant être adaptées à différents besoins.
Les bâtiments existants sont en revanche majoritairement proposés en finition complète, voire partiellement meublés. Dans ce cas, la sécurité commerciale et l’utilisation immédiate sont prioritaires. De nombreuses surfaces étaient déjà louées et ne sont que rarement désaménagées, car une telle démarche serait économiquement peu judicieuse. En outre, les locataires de bâtiments plus anciens privilégient généralement des solutions prêtes à l’emploi, les infrastructures existantes ne correspondant souvent plus au standard d’un aménagement semi-fini moderne.
Le niveau de finition influence directement la durée d’insertion : les surfaces en gros œuvre ou avec un aménagement de base restent en moyenne le plus longtemps sur le marché, tandis que les concepts immédiatement utilisables tels que Plug & Work ou coworking sont loués beaucoup plus rapidement aux utilisateurs finaux (figure 11).
Une partie de ces différences s’explique par la taille des surfaces : des niveaux de finition plus bas vont – comme indiqué précédemment – souvent de pair avec de grands objets présentant dès le départ une durée d’insertion plus longue. L’emplacement et l’année de construction jouent également un rôle essentiel : les surfaces situées dans de meilleurs emplacements, ainsi que les nouvelles constructions, affichent des durées de commercialisation nettement plus courtes. Néanmoins, l’influence du niveau de finition sur la durée d’insertion demeure, même lorsque ces facteurs sont pris en compte.
Une raison essentielle réside dans le fait que les propriétaires de grandes surfaces recherchent souvent des contrats de location plus longs que pour les petites surfaces. Ils prennent donc volontairement davantage de temps pour trouver le locataire adéquat pour une relation locative de longue durée. S’y ajoutent des processus décisionnels plus complexes du côté des locataires, un effort de planification supplémentaire pour les surfaces encore à aménager, ainsi qu’un nombre plus restreint de candidats potentiels dans le segment des grandes surfaces.
Dans l’ensemble, il apparaît que les surfaces flexibles et immédiatement utilisables sont louées plus rapidement, tandis que les objets non aménagés ou de très grande taille nécessitent des processus de commercialisation plus longs – notamment en raison d’exigences différentes et d’horizons temporels plus étendus.
Pour déterminer les différences moyennes de loyers entre les niveaux de finition, les loyers de l’offre ont été analysés à l’aide d’un modèle de régression linéaire. La catégorie de référence était l'aménagement complet, la plus fréquente dans les données analysées. Les principaux facteurs d’influence – tels que la taille de la surface, la localisation (micro et macro-situation), l’âge du bâtiment, l’étage et les différences cantonales – ont été pris en compte afin de faire ressortir les écarts de prix ajustés entre les niveaux de finition.
L’analyse livre un constat clair : les surfaces de coworking affichent en moyenne des loyers d’environ 29 % plus élevés pour les utilisateurs finaux que les surfaces en aménagement complet comparables (figures 12 et 13). Ce résultat s’explique à la fois par une plus grande flexibilité de la durée des contrats de location et par les services supplémentaires proposés au-delà de la simple mise à disposition de la surface. Les surfaces meublées ou Plug & Work peuvent également être louées avec une prime d’environ 14 %. Le fait qu’elles soient immédiatement utilisables et nécessitent un investissement initial moindre accroît la disposition à payer des locataires.
Il convient de souligner que les différences en pourcentage indiquées se rapportent à un objet moyen. Pour les surfaces meublées et les espaces de coworking, la combinaison du niveau de finition, de la macro-situation et du niveau de prix influe nettement sur les primes de loyer : dans les emplacements très recherchés, où les loyers de l’offre sont déjà élevés, les primes en pourcentage sont nettement plus faibles. Pour les niveaux de finition inférieurs, aucune influence comparable de la macrolocalisation n’a pu être démontrée, comme on pouvait s’y attendre.
Au bas de l’échelle des loyers se situent les surfaces en gros œuvre, proposées avec des loyers de l’offre environ 9 % inférieurs à ceux des surfaces en aménagement complet. Les surfaces en aménagement de base ou semi-fini affichent une décote d’environ 3 %. Avant que ces surfaces puissent être utilisées, des investissements supplémentaires dans l’aménagement ainsi qu’une phase préalable de planification et de coordination sont nécessaires. Cet effort supplémentaire incombe aux locataires, ce qui réduit leur disposition à payer. En outre, la disposition à payer pour des surfaces non aménagées est généralement plus faible dans un environnement de marché où la flexibilité et la disponibilité rapide sont valorisées.
L’analyse des annonces est sans équivoque : le niveau de finition est déterminant pour le positionnement sur le marché des surfaces de bureaux. Les surfaces immédiatement utilisables, meublées ou espaces de coworking se louent généralement plus rapidement et affichent, par rapport à la catégorie « aménagement complet », des primes de loyer souvent marquées, mais sont en contrepartie associées à des durées de bail plus courtes.
Les surfaces non aménagées se rencontrent principalement dans les grandes constructions neuves. Elles présentent généralement des durées de commercialisation plus longues et sont proposées avec des décotes par rapport aux surfaces entièrement aménagées. Elles n’en demeurent pas moins attractives pour les investisseurs : les grandes entreprises privilégient souvent un aménagement locatif personnalisé, tandis que les propriétaires bénéficient de coûts de construction plus faibles et d’investissements initiaux réduits.
La tendance haussière des loyers de l’offre pour les surfaces de bureaux s’est pour l’instant poursuivie : au 2ᵉ trimestre 2025, les loyers ont augmenté de 2,7 % à l’échelle nationale (figure 14). Cette hausse est principalement portée par les centres urbains. En revanche, la dynamique s’atténue dans les sites moins bien desservis et dans les régions où la vacance est élevée. À l’échelle régionale, une polarisation se dessine : à Zurich (+3,2 %) et sur l’arc lémanique (+3,8 %), la tendance à la hausse se poursuit sans faiblir, tandis qu’à Bâle (+0,7 %), à Berne (+1,0 %) et dans le reste de la Suisse (+1,4 %), le rythme s’est nettement ralenti.
Le fait que les loyers médians de l’offre aient enregistré la plus forte hausse précisément dans la région lémanique – malgré une liquidité accrue à Genève – s’explique aussi par l’augmentation du nombre de surfaces bien situées et dotées d’un niveau de finition supérieur. Ainsi, les hausses de loyers observées sur l’arc lémanique résultent non seulement d’une évolution de la demande, mais aussi d’une amélioration qualitative : une offre de meilleure qualité tire les loyers vers le haut.
Dans les emplacements de premier ordre des grands centres, une légère tendance à la hausse se dessine à nouveau. Cela indique que les objets de haute qualité, situés dans des quartiers bien desservis, restent fortement demandés et atteignent des prix élevés. À Genève en particulier, les loyers « prime » ont nettement augmenté depuis le début de l’année et se situent actuellement autour de 1000 francs par mètre carré et par an, soit une hausse d’environ 8 % par rapport à l’année précédente.
À Zurich, les loyers « prime » sont restés globalement stables dernièrement ; la différence positive avec Genève persiste toutefois : avec environ 1100 francs par mètre carré et par an, le niveau des prix dans la cité de la Limmat demeure nettement supérieur. L’écart ouvert entre les deux marchés depuis la mi-2022 s’est récemment quelque peu réduit, sans pour autant modifier la position relative des deux villes.
Les autres grandes villes affichent elles aussi des tendances stables à légèrement haussières. À Berne, les loyers « prime » ont augmenté sur un an, passant d’environ 390 à 450 francs suisses par mètre carré et par an. Lausanne a enregistré une nette revalorisation : les immeubles de premier ordre atteignent désormais quelque 470 francs suisses par mètre carré et par an, soit une hausse d’environ 4 %. À Bâle, après le léger repli enregistré l’an dernier, une reprise modérée s’est amorcée ; les loyers « prime » y ont ainsi retrouvé leur niveau du même trimestre de 2024.
La demande émanant des secteurs de bureaux classiques devrait se développer plus faiblement qu’au cours des dernières années. Pour l’année en cours, nous anticipons une croissance de l’emploi inférieure à la moyenne, de +0,8 %. En raison des incertitudes conjoncturelles, le marché du travail ne devrait afficher qu’une évolution modérée l’an prochain ; ce n’est qu’en 2027 que nous prévoyons un regain sensible de dynamisme (figure 16).
Dans les marchés présentant déjà un excédent de l’offre, une pression à la baisse sur les loyers est à prévoir. Les surfaces modernes, bien desservies et répondant aux meilleurs standards de durabilité devraient, en revanche, continuer à bien résister. En moyenne suisse, nous anticipons pour 2026 une légère baisse des loyers de l’offre de −0,6 %. Il faut également s’attendre à un léger allongement de la durée d’insertion et à une offre en légère expansion.
Wüest Partner dispose de vastes bases de données qui alimentent les analyses présentées ici et est responsable du calcul ainsi que de la présentation des données. Par ailleurs, les sources de données suivantes ont été utilisées pour cet article :
Infopro Digital, Office fédéral de la statistique (OFS), Swiss Valuation Standards, Wüest Partner